complément au cours 1ère partie
licence sciences de l'education :: second semestre :: approches disciplinaires de l'éducation :: histoire de l'enfant et de l'adolescence
Page 1 sur 1
 complément au cours 1ère partie
complément au cours 1ère partie
1 Histoire de l’enfance : Présentation
enfance, histoire de l', histoire des soins et des sentiments accordés aux enfants, et de l’évolution du statut que les sociétés occidentales leur octroient.
Jusqu’à une époque récente, il n’existe pratiquement aucun écrit d’enfant ; par conséquent, l’histoire de l’enfance est, avant tout, une histoire du regard que les adultes ont porté sur les enfants. De fait, pour la plupart des périodes, l’enfance n’est connue de l’historien que par le filtre des pédagogues, des législateurs et ou des artistes.
Mais comme la majorité de ces écrits et portraits s’attardent sur l’enfant des milieux privilégiés — le cas de la jeunesse de Louis XIII, fortement détaillée, est évocatrice de cet intérêt — l’historien doit souvent avoir recours aux résultats de l’archéologie et à une documentation indirecte pour établir une histoire de ces enfances. À ces informations diffuses s’ajoute le problème de la définition de l’enfance : s’arrête-t-elle avec l’âge traditionnel de raison (sept ans), avec la capacité de travailler ou avec la majorité civique comme nous l’entendons aujourd’hui ? Afin de n’en exclure aucune, toutes ces enfances vont, en définitive, être retracées.
2 Le « sentiment de l’enfance »
À la suite des travaux pionniers de Philippe Ariès (l’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, 1960), l’historien a considéré que l’enfance était un concept mal défini avant le XVIIIe siècle et qu’il était pratiquement impossible d’en faire l’histoire. En outre, il pensait que les parents des siècles passés, dans un contexte de très fortes natalité et mortalité infantile, restaient relativement indifférents à leurs nombreux et éphémères enfants, autrement dit qu’ils n’avaient pas « le sentiment de l’enfance ».
Depuis quelques années, la majorité des chercheurs a complètement remis en cause ces premiers résultats d’étude ; les historiens ont montré qu’il ne fallait pas juger l’enfance dans l’histoire à l’aune de nos valeurs contemporaines, mais qu’il convenait, en faisant preuve de relativisme culturel et en abandonnant l’idée d’un progrès continu dans le domaine de l’histoire des mentalités, d’observer l’enfance dans son contexte démographique, social et religieux. Ainsi, les chercheurs peuvent aujourd’hui affirmer que, de tout temps, les parents ont manifesté, selon les valeurs en cours, un intérêt et des sentiments à l’égard de l’enfance.
3 L’enfant dans l’Antiquité
3.1 En Grèce
Dans la Grèce antique, la communauté citadine semble avoir une considération limitée pour l’enfant, jugé trop fragile et non productif. Ainsi, à Sparte (VIIIe-VIe siècle av. J.-C.), cité guerrière par excellence, les enfants nés handicapés sont systématiquement tués. En revanche, les enfants valides sont élevés dans l’oikos (maison) jusqu’à l’âge de sept ans, puis quittent le foyer parental pour recevoir une éducation de groupe (agélai) qui vise à assurer leur socialisation et leur soumission au chef. Outre l’apprentissage de la lecture, de la rhétorique, du chant ou de la danse, la stricte éducation « à la spartiate » consiste essentiellement à endurcir le corps : l’enfant doit affronter le froid et la faim, multiplier les exercices physiques (chasse, lutte, attaques nocturnes, etc.), autant d’activités qui doivent le former à sa future condition guerrière de citoyen.
Dans la cité athénienne (VIe-IVe siècle av. J.-C.), les conditions de l’enfant sont plus favorables. La naissance donne lieu à des réjouissances dans la cité : « la fête du dixième jour » est un rituel d’intégration au cours duquel le nouveau-né, âgé de dix jours, est déposé à l’extérieur de la maison, avant que son géniteur le montre à la communauté, le reconnaisse publiquement comme son fils légitime et lui donne un nom. L’enfant est ensuite présenté et inscrit dans une phratrie (ensemble des individus qui se réclament d’un ancêtre commun). Il passe ses premières années dans sa famille, allaité jusqu’à deux ou trois ans, ne manquant pas d’amour, se livrant souvent à des jeux comme la balançoire, le cerf-volant, le saut à la corde, la balle, la toupie ou la poupée. La fille reste généralement dans la maison paternelle jusqu’à son mariage, tandis que le garçon, dans les milieux aisés (seuls milieux vraiment éclairés par les sources), va à l’école. À dix-huit ans, le jeune homme est inscrit, comme tout citoyen athénien, sur les registres du dème. Il devient éphèbe et est alors considéré comme un citoyen à part entière.
3.2 À Rome
Les sentiments des Romains à l’égard de leurs enfants sont tout autant ambivalents ; ces derniers peuvent être aimés et chéris ou méprisés et délaissés, ce qui permet des réactions aussi diverses que l’avortement, l’infanticide ou l’abandon d’enfants. Effectivement, signe sans doute d’une pratique courante de l’avortement, certaines nécropoles fouillées par les archéologues présentent un taux important d’enfants proches du terme parmi la population inhumée. De plus, il est exceptionnel que les enfants morts avant l’âge d’un an soient notés dans les textes ou sur les tombes ; il semble que certains cadavres sont même utilisés pour interroger l’au-delà, comme si le tout-petit décédé, à peine entré dans ce monde, garde un lien étroit avec les forces de l’invisible.
En fait, dans la société romaine, la puissance paternelle (patria potestas) est si forte que le législateur octroie au père le droit de vie et de mort sur son enfant. Ainsi, immédiatement après la naissance, le chef de famille, en signe de reconnaissance, prend le bébé dans ses bras et l’élève ; si c’est une fille, il la met au sein maternel. Lorsqu’il ne procède pas à ces gestes rituels, il ne reconnaît pas l’enfant, qui peut alors être tué ou rendu à la condition servile. Chez les plus démunis, l’infanticide ou l’abandon permet d’éviter d’avoir une bouche supplémentaire à nourrir ; dans les familles aisées, ces pratiques permettent de ne pas trop émietter le patrimoine familial. C’est donc un mode ordinaire de régulation des naissances, et il est rare que les familles romaines, tous niveaux sociaux confondus, aient plus de deux ou trois enfants.
D’une manière générale, l’enfant romain se définit par toute une série d’incompétences dévalorisantes. L’infans (« qui ne parle pas », qui fari non potest) est jugé comme un être imparfait au regard de l’adulte : petite taille, absence de parole ou parole mal contrôlée, incapacité à marcher, à être autonome. Mais cela n’empêche pas, au cours de l’Empire romain, l’essor d’une attention affective et institutionnelle. Ainsi, le vocabulaire servant à désigner l’enfant, aux différents âges de la vie, se diversifie et traduit souvent des signes d’affectivité. Certaines qualités qui lui sont reconnues jouent en sa faveur, comme son innocence et son état de grande pureté.
Chez les Romains, l’enfant noble est rarement nourri par sa mère : son berceau est placé dans la chambre d’une nourrice qu’il quitte après son sevrage, vers l’âge de deux ou trois ans. Durant les deux premiers mois de son existence, il est serré très fort dans des bandelettes, afin que son corps ne se déforme pas. À partir de la pueritia (après l’âge de sept ans), on s’occupe de l’éducation de son corps et de son l’esprit : règles de maintien, apprentissage des bonnes manières.
4 L’enfant médiéval
Du fait du manque d’hygiène, de la malnutrition et des maladies infantiles face auxquelles la médecine reste impuissante, la mortalité infantile est toujours très importante durant le Moyen Âge ; des estimations laissent à penser que 30 p. 100 des nouveau-nés meurent avant d’atteindre l’âge d’un an et que la très forte fécondité (il n’est pas rare pour une femme de mettre au monde plus de dix enfants) permet à peine le renouvellement des générations.
4.1 L’image du nouveau-né
C’est sans doute la raison pour laquelle l’époque médiévale hérite de la double vision antique de l’enfance : la première, abondamment développée par saint Augustin, insiste sur les incapacités, imperfections et infirmités de l’enfant, forçant les analogies avec le nain pour sa petite taille, le fou ou l’homme ivre pour son manque de raison, la femme pour sa parole incontrôlée. L’autre image, très positive, met au contraire l’accent sur la pureté et l’innocence de l’enfant.
Incontestablement, le christianisme a tendance à renforcer cette seconde conception. Dès le haut Moyen Âge, un ensemble de lois, accentuant une tendance déjà sensible au Bas-Empire dans les sociétés romaines et germaniques, vise à protéger l’enfant : pour exemple, interdiction est faite à partir du IVe siècle, sous peine d’excommunication ou de mort, de pratiquer l’avortement ou l’infanticide. Les condamnations récurrentes au cours du haut Moyen Âge renseignent autant sur une réelle volonté de protéger l’enfance que sur la réalité de pratiques abortives, voire d’infanticides, conséquences d’une époque particulièrement troublée par les invasions, les pestes et famines.
En particulier, le tout petit enfant, celui qui n’a pas encore l’usage de la parole, est fortement valorisé tout au cours du Moyen Âge. S’il a reçu le baptême — n’ayant pas encore commis de péchés personnels —, il est considéré comme un être sacré, innocent et impeccable, symbole de pureté et d’innocence. Aussi, s’appuyant sur les paroles scripturaires — « De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t’es ménagé une louange… » (Évangile selon saint Matthieu, XXI, 16) —, les hommes du Moyen Âge aiment-ils à développer des analogies entre le Christ et le nouveau-né, à faire parler l’infans pour transmettre la parole divine.
4.2 L’amour maternel
L’analogie est significative dans les arts, où l’amour maternel est toujours à l’image de celui que la Vierge porte au Christ-enfant. Les premières représentations, figées, cèdent bientôt la place à une Vierge au sein nu, allaitant elle-même son nourrisson. Il est vrai que la mère se charge souvent de nourrir son enfant et, lorsque son dernier enfant est remis aux bons soins d’une nourrice, celle-ci est choisie pour ses qualités, car la tradition veut que le lait soit perçu comme moyen de transmission des vertus.
4.3 L’éducation et l’enseignement
Quels que soient son sexe, son âge ou son rang dans la fratrie, l’enfant médiéval est généralement entouré d’une grande affection par ses proches qui ont le souci constant de son éducation. La première se déroule essentiellement à la maison, aux côtés des parents qui lui enseignent surtout la foi chrétienne — afin d’assurer son salut — et les gestes du métier jusqu’à ce que, de charge, il devienne un acteur économique.
En revanche, dans les milieux chevaleresques, l’enfant est placé, à partir de dix ou douze ans, chez un aristocrate de plus haut rang (souvent l’oncle maternel) pour parfaire son éducation : ce fosterage consiste en la pratique de l’équitation, l’apprentissage de l’art de la chasse et du maniement des armes. Les plus pauvres peuvent avoir recours à l’oblation pour assurer un avenir à leur progéniture : l’enfant est placé dans un monastère qui l’éduque et le dirige vers le vœu monastique. Enfant donné de façon irrévocable sous les Mérovingiens, l’oblat recouvre sa liberté à défaut de vocation aux débuts de la période carolingienne. Pour les plus aisés existent des écoles, dans les monastères d’abord ou avec un précepteur personnel, puis dans les villes à partir des XIIe-XIIIe siècles.
Les pédagogues humanistes, sans doute encore plus que leurs devanciers médiévaux, insistent sur la nécessité de différencier les âges, de distinguer des étapes dans l’enfance et donc d’adapter le comportement et le discours de l’adulte en fonction de ces données. D’où un débat important pour définir l’âge d’entrée à l’école, à une époque où celle-ci se développe. De même, en complément de l’enseignement classique (où le latin a une place privilégiée), les humanistes remettent à l’honneur l’exercice physique prôné par les Anciens ; ainsi, vers 1433-1434, l’homme de lettres Leon Battista Alberti écrit que « l’exercice peut beaucoup pour le corps, et encore plus pour l’âme si nous veillons à le pratiquer avec raison ».
enfance, histoire de l', histoire des soins et des sentiments accordés aux enfants, et de l’évolution du statut que les sociétés occidentales leur octroient.
Jusqu’à une époque récente, il n’existe pratiquement aucun écrit d’enfant ; par conséquent, l’histoire de l’enfance est, avant tout, une histoire du regard que les adultes ont porté sur les enfants. De fait, pour la plupart des périodes, l’enfance n’est connue de l’historien que par le filtre des pédagogues, des législateurs et ou des artistes.
Mais comme la majorité de ces écrits et portraits s’attardent sur l’enfant des milieux privilégiés — le cas de la jeunesse de Louis XIII, fortement détaillée, est évocatrice de cet intérêt — l’historien doit souvent avoir recours aux résultats de l’archéologie et à une documentation indirecte pour établir une histoire de ces enfances. À ces informations diffuses s’ajoute le problème de la définition de l’enfance : s’arrête-t-elle avec l’âge traditionnel de raison (sept ans), avec la capacité de travailler ou avec la majorité civique comme nous l’entendons aujourd’hui ? Afin de n’en exclure aucune, toutes ces enfances vont, en définitive, être retracées.
2 Le « sentiment de l’enfance »
À la suite des travaux pionniers de Philippe Ariès (l’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, 1960), l’historien a considéré que l’enfance était un concept mal défini avant le XVIIIe siècle et qu’il était pratiquement impossible d’en faire l’histoire. En outre, il pensait que les parents des siècles passés, dans un contexte de très fortes natalité et mortalité infantile, restaient relativement indifférents à leurs nombreux et éphémères enfants, autrement dit qu’ils n’avaient pas « le sentiment de l’enfance ».
Depuis quelques années, la majorité des chercheurs a complètement remis en cause ces premiers résultats d’étude ; les historiens ont montré qu’il ne fallait pas juger l’enfance dans l’histoire à l’aune de nos valeurs contemporaines, mais qu’il convenait, en faisant preuve de relativisme culturel et en abandonnant l’idée d’un progrès continu dans le domaine de l’histoire des mentalités, d’observer l’enfance dans son contexte démographique, social et religieux. Ainsi, les chercheurs peuvent aujourd’hui affirmer que, de tout temps, les parents ont manifesté, selon les valeurs en cours, un intérêt et des sentiments à l’égard de l’enfance.
3 L’enfant dans l’Antiquité
3.1 En Grèce
Dans la Grèce antique, la communauté citadine semble avoir une considération limitée pour l’enfant, jugé trop fragile et non productif. Ainsi, à Sparte (VIIIe-VIe siècle av. J.-C.), cité guerrière par excellence, les enfants nés handicapés sont systématiquement tués. En revanche, les enfants valides sont élevés dans l’oikos (maison) jusqu’à l’âge de sept ans, puis quittent le foyer parental pour recevoir une éducation de groupe (agélai) qui vise à assurer leur socialisation et leur soumission au chef. Outre l’apprentissage de la lecture, de la rhétorique, du chant ou de la danse, la stricte éducation « à la spartiate » consiste essentiellement à endurcir le corps : l’enfant doit affronter le froid et la faim, multiplier les exercices physiques (chasse, lutte, attaques nocturnes, etc.), autant d’activités qui doivent le former à sa future condition guerrière de citoyen.
Dans la cité athénienne (VIe-IVe siècle av. J.-C.), les conditions de l’enfant sont plus favorables. La naissance donne lieu à des réjouissances dans la cité : « la fête du dixième jour » est un rituel d’intégration au cours duquel le nouveau-né, âgé de dix jours, est déposé à l’extérieur de la maison, avant que son géniteur le montre à la communauté, le reconnaisse publiquement comme son fils légitime et lui donne un nom. L’enfant est ensuite présenté et inscrit dans une phratrie (ensemble des individus qui se réclament d’un ancêtre commun). Il passe ses premières années dans sa famille, allaité jusqu’à deux ou trois ans, ne manquant pas d’amour, se livrant souvent à des jeux comme la balançoire, le cerf-volant, le saut à la corde, la balle, la toupie ou la poupée. La fille reste généralement dans la maison paternelle jusqu’à son mariage, tandis que le garçon, dans les milieux aisés (seuls milieux vraiment éclairés par les sources), va à l’école. À dix-huit ans, le jeune homme est inscrit, comme tout citoyen athénien, sur les registres du dème. Il devient éphèbe et est alors considéré comme un citoyen à part entière.
3.2 À Rome
Les sentiments des Romains à l’égard de leurs enfants sont tout autant ambivalents ; ces derniers peuvent être aimés et chéris ou méprisés et délaissés, ce qui permet des réactions aussi diverses que l’avortement, l’infanticide ou l’abandon d’enfants. Effectivement, signe sans doute d’une pratique courante de l’avortement, certaines nécropoles fouillées par les archéologues présentent un taux important d’enfants proches du terme parmi la population inhumée. De plus, il est exceptionnel que les enfants morts avant l’âge d’un an soient notés dans les textes ou sur les tombes ; il semble que certains cadavres sont même utilisés pour interroger l’au-delà, comme si le tout-petit décédé, à peine entré dans ce monde, garde un lien étroit avec les forces de l’invisible.
En fait, dans la société romaine, la puissance paternelle (patria potestas) est si forte que le législateur octroie au père le droit de vie et de mort sur son enfant. Ainsi, immédiatement après la naissance, le chef de famille, en signe de reconnaissance, prend le bébé dans ses bras et l’élève ; si c’est une fille, il la met au sein maternel. Lorsqu’il ne procède pas à ces gestes rituels, il ne reconnaît pas l’enfant, qui peut alors être tué ou rendu à la condition servile. Chez les plus démunis, l’infanticide ou l’abandon permet d’éviter d’avoir une bouche supplémentaire à nourrir ; dans les familles aisées, ces pratiques permettent de ne pas trop émietter le patrimoine familial. C’est donc un mode ordinaire de régulation des naissances, et il est rare que les familles romaines, tous niveaux sociaux confondus, aient plus de deux ou trois enfants.
D’une manière générale, l’enfant romain se définit par toute une série d’incompétences dévalorisantes. L’infans (« qui ne parle pas », qui fari non potest) est jugé comme un être imparfait au regard de l’adulte : petite taille, absence de parole ou parole mal contrôlée, incapacité à marcher, à être autonome. Mais cela n’empêche pas, au cours de l’Empire romain, l’essor d’une attention affective et institutionnelle. Ainsi, le vocabulaire servant à désigner l’enfant, aux différents âges de la vie, se diversifie et traduit souvent des signes d’affectivité. Certaines qualités qui lui sont reconnues jouent en sa faveur, comme son innocence et son état de grande pureté.
Chez les Romains, l’enfant noble est rarement nourri par sa mère : son berceau est placé dans la chambre d’une nourrice qu’il quitte après son sevrage, vers l’âge de deux ou trois ans. Durant les deux premiers mois de son existence, il est serré très fort dans des bandelettes, afin que son corps ne se déforme pas. À partir de la pueritia (après l’âge de sept ans), on s’occupe de l’éducation de son corps et de son l’esprit : règles de maintien, apprentissage des bonnes manières.
4 L’enfant médiéval
Du fait du manque d’hygiène, de la malnutrition et des maladies infantiles face auxquelles la médecine reste impuissante, la mortalité infantile est toujours très importante durant le Moyen Âge ; des estimations laissent à penser que 30 p. 100 des nouveau-nés meurent avant d’atteindre l’âge d’un an et que la très forte fécondité (il n’est pas rare pour une femme de mettre au monde plus de dix enfants) permet à peine le renouvellement des générations.
4.1 L’image du nouveau-né
C’est sans doute la raison pour laquelle l’époque médiévale hérite de la double vision antique de l’enfance : la première, abondamment développée par saint Augustin, insiste sur les incapacités, imperfections et infirmités de l’enfant, forçant les analogies avec le nain pour sa petite taille, le fou ou l’homme ivre pour son manque de raison, la femme pour sa parole incontrôlée. L’autre image, très positive, met au contraire l’accent sur la pureté et l’innocence de l’enfant.
Incontestablement, le christianisme a tendance à renforcer cette seconde conception. Dès le haut Moyen Âge, un ensemble de lois, accentuant une tendance déjà sensible au Bas-Empire dans les sociétés romaines et germaniques, vise à protéger l’enfant : pour exemple, interdiction est faite à partir du IVe siècle, sous peine d’excommunication ou de mort, de pratiquer l’avortement ou l’infanticide. Les condamnations récurrentes au cours du haut Moyen Âge renseignent autant sur une réelle volonté de protéger l’enfance que sur la réalité de pratiques abortives, voire d’infanticides, conséquences d’une époque particulièrement troublée par les invasions, les pestes et famines.
En particulier, le tout petit enfant, celui qui n’a pas encore l’usage de la parole, est fortement valorisé tout au cours du Moyen Âge. S’il a reçu le baptême — n’ayant pas encore commis de péchés personnels —, il est considéré comme un être sacré, innocent et impeccable, symbole de pureté et d’innocence. Aussi, s’appuyant sur les paroles scripturaires — « De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t’es ménagé une louange… » (Évangile selon saint Matthieu, XXI, 16) —, les hommes du Moyen Âge aiment-ils à développer des analogies entre le Christ et le nouveau-né, à faire parler l’infans pour transmettre la parole divine.
4.2 L’amour maternel
L’analogie est significative dans les arts, où l’amour maternel est toujours à l’image de celui que la Vierge porte au Christ-enfant. Les premières représentations, figées, cèdent bientôt la place à une Vierge au sein nu, allaitant elle-même son nourrisson. Il est vrai que la mère se charge souvent de nourrir son enfant et, lorsque son dernier enfant est remis aux bons soins d’une nourrice, celle-ci est choisie pour ses qualités, car la tradition veut que le lait soit perçu comme moyen de transmission des vertus.
4.3 L’éducation et l’enseignement
Quels que soient son sexe, son âge ou son rang dans la fratrie, l’enfant médiéval est généralement entouré d’une grande affection par ses proches qui ont le souci constant de son éducation. La première se déroule essentiellement à la maison, aux côtés des parents qui lui enseignent surtout la foi chrétienne — afin d’assurer son salut — et les gestes du métier jusqu’à ce que, de charge, il devienne un acteur économique.
En revanche, dans les milieux chevaleresques, l’enfant est placé, à partir de dix ou douze ans, chez un aristocrate de plus haut rang (souvent l’oncle maternel) pour parfaire son éducation : ce fosterage consiste en la pratique de l’équitation, l’apprentissage de l’art de la chasse et du maniement des armes. Les plus pauvres peuvent avoir recours à l’oblation pour assurer un avenir à leur progéniture : l’enfant est placé dans un monastère qui l’éduque et le dirige vers le vœu monastique. Enfant donné de façon irrévocable sous les Mérovingiens, l’oblat recouvre sa liberté à défaut de vocation aux débuts de la période carolingienne. Pour les plus aisés existent des écoles, dans les monastères d’abord ou avec un précepteur personnel, puis dans les villes à partir des XIIe-XIIIe siècles.
Les pédagogues humanistes, sans doute encore plus que leurs devanciers médiévaux, insistent sur la nécessité de différencier les âges, de distinguer des étapes dans l’enfance et donc d’adapter le comportement et le discours de l’adulte en fonction de ces données. D’où un débat important pour définir l’âge d’entrée à l’école, à une époque où celle-ci se développe. De même, en complément de l’enseignement classique (où le latin a une place privilégiée), les humanistes remettent à l’honneur l’exercice physique prôné par les Anciens ; ainsi, vers 1433-1434, l’homme de lettres Leon Battista Alberti écrit que « l’exercice peut beaucoup pour le corps, et encore plus pour l’âme si nous veillons à le pratiquer avec raison ».
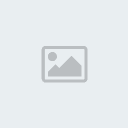
thierry- Messages : 18
Date d'inscription : 06/11/2008
 Sujets similaires
Sujets similaires» complément au cours 2nde partie
» complément de la semaine 5
» petit complément trouvé sur le net pour analyser l'image publicitaire
» cours 1 03/02/09
» cours 8 30/03/09
» complément de la semaine 5
» petit complément trouvé sur le net pour analyser l'image publicitaire
» cours 1 03/02/09
» cours 8 30/03/09
licence sciences de l'education :: second semestre :: approches disciplinaires de l'éducation :: histoire de l'enfant et de l'adolescence
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
